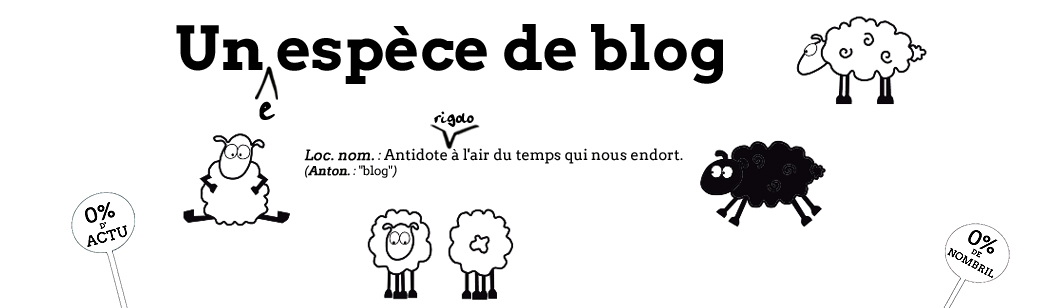De même que le lion est le roi des animaux, le canapé règne en maître incontesté sur le living, ne craignant ni fauteuils, ni sofas, ni chauffeuses en tous genres. Soulevons-lui les coussins avec précaution.
Mais revenons à nos moutons, moutons.
Le monde culinaire, lui, n’a pas hésité à descendre canapé de son piédestal pour le réduire à l’état de
tranche de pain de mie taillée en rectangle, frite ou grillée, dont l’épaisseur et la grandeur varient suivant le mets qu’elle doit supporter.
Toujours riquiqui, toujours au pluriel.
Remarquez qu’on n’a pas eu plus d’égards pour le lit, cet autre suzerain déchu.
Le dénigrement du canapé date du temps où il désignait encore un
groupe très restreint de personnes soucieuses de demeurer entre elles.
Un club, pour rester dans la famille sandwich.
C’est en -300 avant Ikéa qu’apparaissent les premiers canapés. Ces spécimens de « large siège à dossier où peuvent s’asseoir plusieurs personnes » ont déjà évolué depuis le conopé « rideau de lit » de 1180.
Début XVIe, on peut aussi croiser canope au sens de « moustiquaire ». Ne vous rappelé-ce pas canopée, cette couverture feuillue qui plonge la forêt dans la semi-pénombre ?
C’est que conopé n’est qu’un recyclage de la « moustiquaire » latine conopeum, gaulée au grec kônôpeîon. Et qui dit moustiquaire dit kônôps, zzz’aurez beau faire. Si ce khônnaud de moustique est conoïde, normal : c’est précisément son kônos (« cône ») qui lui permet de pomper, pompé sur l’indo-européen ko– ou ku- exprimant l’idée d’« aiguisé », déguisée en coin.
Au prochain moustique, plutôt que de le regarder en coin, planquez-vous sous le canapé.
Merci de votre attention.