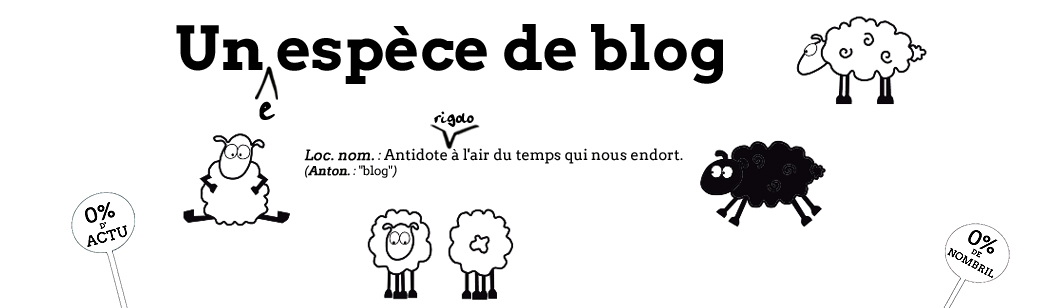En voilà un qui n’a pas les honneurs qu’il mérite. Doit-on rappeler que svelte est le seul cas de –sv– connu ? Hormis svastika et barmitsva, qui ne se supportent guère, et svklmprh%b, quand minou joue trop près du clavier.
Mais revenons à nos moutons, moutons.
Svelte est si peu banal qu’on ne saurait dire d’où il vient. L’épithète fait d’ailleurs feu de tout bois. De l’édifice « élancé » (sens premier), on est passé à une personne de silhouette comparable :
svelte amazone
et même aux animaux :
sveltes lévriers,
végétaux :
svelte lys,
quand ce ne sont pas des objets :
lampe svelte,
voire une œuvre d’art :
svelte trille.
Quant à sveltesse, on l’associe à ce point à « minceur » qu’un yaourt éponyme clame à qui veut l’entendre 0% de matière grasse.
Tardif (1642), svelte doit son existence au rital svelto, formé sur le participe de svellere, du latin evellere, « arracher ». Côté violent qu’on avait perdu à force de minauder.
Ceusses qui ont des lettres supputent déjà qu’une partie du préfixe ex- s’est érodée au contact du v. Reste alors vellere, « tirer », dont le participe fait vulsi, souchon de la convulsion qui résulte de convellere (« arracher le plumage » ou « déboiter un membre » selon le degré de cruauté). Idem pour revellere (« enlever de force »), qui s’est révélé révulser. Sans oublier vulnus (« blessure » → vulnérable) ni vultur (vautour en VO), bien connu pour dépouiller les carcasses.
D’aucuns font descendre le verbe vellere du nom vellus, « toison », venu de l’indo-européen vel-, « poil, herbe, toison », qu’on retrouve aussi bien dans velu que dans la « laine » british wool.
Si le chat recommence, arrachez-lui les poils, ça le rendra plus svelte.
Merci de votre attention.