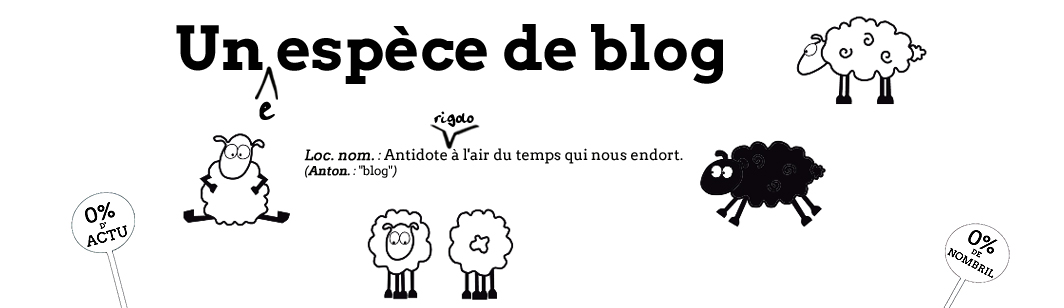Suite à l’étymo de coton, nous avions laissé coton-tige en rase campagne. Lavons l’affront et procédons sans plus attendre à l’examen de tige.
Mais revenons à nos moutons, moutons.
Pour faire simple, est considérée comme tige la « partie axiale de la plante ».
D’où le sens figuré, désormais perdu :
premier père, fondateur d’où sont sorties toutes les branches d’une famille :
La tige capétienne.
D’où l’encore plus has-been « faire tige » (« avoir une descendance »), qui n’a guère fait tige que dans la chanson fétiche d’Alain Bashung Faire tige de l’amour.
Puis par analogie :
élément long et mince, de section généralement circulaire, appartenant à un mécanisme.
Les métaphores coquines ayant tôt fait de fleurir (ta-ta-ta, on vous connaît), il fut un temps où l’on pouvait même se faire
brouter la tige,
le cas échéant par une belle plante, dans une mise en abyme qui vaudrait le détour si elle ne nous éloignait outrageusement du sujet.
Equivalent de « tronc » au début du XIIe siècle, tige pousse sur le latin tibia. Ce qui, a priori, est à se tenir les côtes. Mais tout bien considéré, ce cher os, par son côté longiligne, n’évoque-t-il pas une tige dans toute sa splendeur ?
Racine indo-européenne tuibh (« creux ») qui nous a permis au passage de siphonner leur siphon aux Grecs.
Le passage de tibia à tige, lui, se perd dans la nuit des temps. Mais il est bon parfois de préserver le mystère, surtout quand on songe aux « coton-tibias », « tibia capétien » et autres « faire tibia » auxquels nous avons échappé.
Quant à se faire « brouter le tibia », on en frissonne rien qu’à l’idée.
Merci de votre attention.