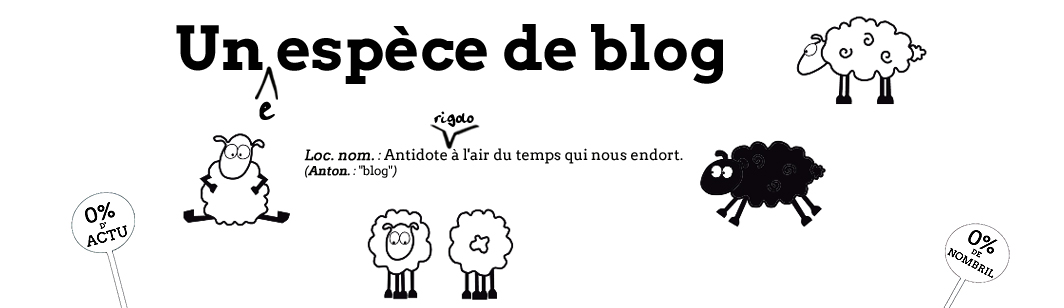Au rayon TV, tous les modèles en démonstration diffusent la même émission en même temps. Or, l’évidence saute aux yeux et surtout aux oreilles : justement non, pas en même temps.
Mais revenons à nos moutons, moutons.
Si toutes les télés sont réglées sur la même chaîne, c’est pour nous permettre de comparer, ça, on pige.
Précisément, comment juger sur un seul son parfaitement synchrone ? Il nous parvient donc dédoublé (dans le meilleur des cas), démultiplié (le plus souvent), à raison d’une fraction de seconde par poste. Si on n’est pas habitué aux installations d’art contemporain, ça donne le tournis. Il y en a qui dégobillent.
Comment sapristoche la fée électricité peut-elle à ce point, alors que la fréquence part de la même Tour Eiffel, voyage à la même vitesse, est restituée par les mêmes composants chinois, manquer de la plus élémentaire simultanéité ?
L’oreille perçoit sans effort cet infime décalage. Mais si l’œil pouvait embrasser le mur de télés dans son ensemble (on ne dira pas « en un clin d’œil » pour ce que ce serait un pléonasme, doublé d’un contresens puisqu’il faut qu’il reste ouvert), il constaterait qu’au niveau de l’image, c’est kif-kif.
Sachant que 98% de la population regarde le petit écran jour et nuit, vous mesurez l’ampleur de l’injustice ?
Dans ces conditions, peut-on encore parler d’événements « en direct » ? Ha ha ha, laissez-nous rire : le concept vole en éclats. Seuls les témoins de la scène ont ce privilège. Nous, nous ne la voyons qu’en « léger différé », variable selon l’équipement.
Et quand la balle est au fond des filets ? Tendez bien l’oreille, les khônnards du dessus laisseront éclater leur joie quelques centièmes de seconde avant vous. Multipliez par le nombre de matches : c’est proprement insupportable.
D’ailleurs, de quels « filets » parle-t-on ? Soit le buteur trouve le petit filet, soit le grand. En aucun cas les deux en même temps, ou alors il faut un très gros ballon.
Les commentateurs devraient profiter du léger différé pour tempérer leurs ardeurs.
Merci de votre attention.